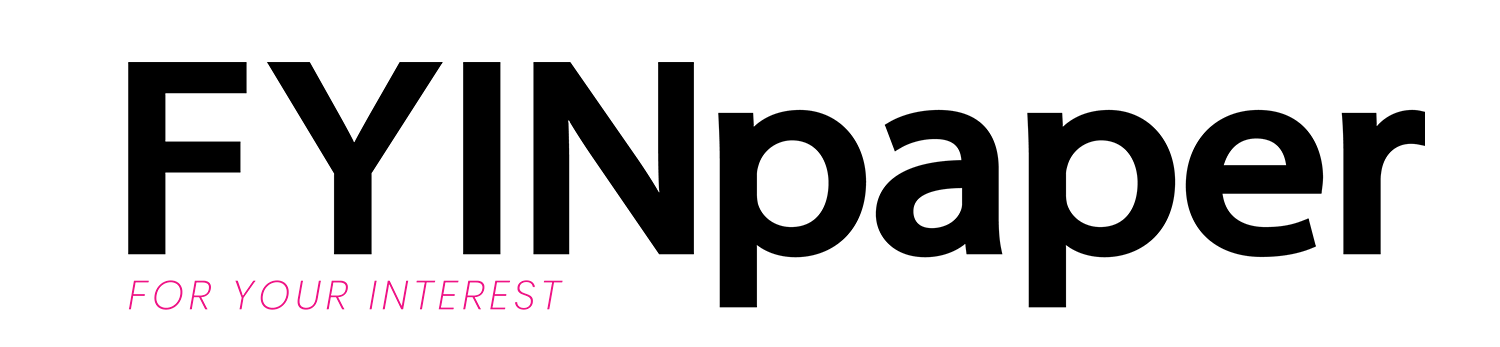L’art abstrait n’a guère plus que cent années d’existence. Ce fut une rupture profonde et déconcertante après des siècles de création artistique en Occident. Du spirituel dans l’art de Vassili Kandinsky a été l’expression la plus radicale d’une révolution sans précédent dans la sphère de la peinture et de la sculpture. Mais elle n’a pas aboli tous les principes qui avaient sous-tendu l’art ancien. Les codes ont changé la lecture et l’intelligence de l’œuvre, qui requièrent, c’est évident, de nouveaux critères. De nouveaux débats esthétiques concernant la forme et le style ont vu le jour et très vite des courants opposés se sont affirmés.
Futurisme (dans certains cas), suprématisme, constructivisme, néoplasticisme, pour ne citer que ceux-là ont métamorphosé ce champ d’investigation qui n’a cessé de croître et de devenir plus complexe. Des groupes et de nouveaux courants n’ont plus cessé de se développer jusqu’à une période récente et les artistes sont allés jusqu’aux confins que ces langages inédits leur permettaient d’aller. La monochromie a été l’une de ces limites. Mais pas la seule. On aurait pu croire que tous les possibles concédés par l’abstraction auraient été épuisés. Ce n’est pas le cas et loin s’en faut.
En ce qui concerne Claude Gesvret, l’idée centrale de sa démarche n’a pas été d’introduire une nouvelle théorie de l’art abstrait s’insinuant entre les précédentes, une manière inconnue de traiter l’abstraction. Il a par conséquent préféré rechercher une autre voie, qui déroge jusqu’à ses fondements les grammaires qui se sont imposées jusque-là dans l’imaginaire picturale.
En premier lieu, son style est impur. C’est-à-dire qu’il ne cantonne pas à quelques exercices pouvant le mener à tracer la cartographie d’un monde qui serait sien et ne partagerait aucune comparaison avec d’autres. Il a voulu dépasser ce stade et rendre sa quête encore plus déconcertante. Il ne conçoit par conséquent pas un «paysage» mental dont il aurait inventé les formes improbables et les couleurs qui obéissent à des lois fantasques. Il n’y a pas un fil rouge qui pourrait relier une toile à l’autre. Et pourtant, il existe bien une cohérence dans ces espaces, mais qui ne répondent pas à des règles fixes.
Ensuite, l’artiste a parfois introduit des éléments figuratifs, souvent fragmentaires ou ébauchés, ne prenant jamais le pas sur le reste de la composition qui demeure informel. Ces intrusions de fragments arrachés à la réalité de l’expérience visuelle ne fait que rendre encore plus énigmatique la composition, qui déjoue toute tentative de système. Mais ce n’est pas pour autant une surface incohérente qui s’offre au regard. Ce serait plus exactement le désir de conjuguer des modes qui, en principe, n’auraient rien en commun.
Il ne s’agit pas pour lui de dépasser l’un et l’autre domaine, mais plutôt d’inscrire une sorte de circumnavigation qui traversent des états différents. Bien sûr, c’est l’abstraction qui l’emporte haut la main, mais en ayant l’audace d’y inclure ces éléments qui appartiennent à notre connaissance spéculaire de ce qui nous entoure. Cette posture ne fait que contribuer à la confrontation avec un espace plein d’ambiguïtés et par définition impur. Dans cette perspective, il ne fait que rendre l’approche de ses créations non seulement problématique, mais aussi mystérieuse. En fin de compte, c’est ce jeu entre le visible et le non visible qui est la clef de son histoire: celle-ci consiste à condenser sur une surface la fiction d’un volume dont les paramètres appartiennent à plusieurs instances de la peinture se retrouvant dans son histoire, surtout celle de la «tradition du nouveau». Il ne fait pas reposer sa cause sur des références historiques, mais sur des plans mentaux qui devraient être disjoints et qu’il s’attache à raccorder.
Et il ne faut pas oublier que les compositions de Claude Gesvret ne répondent jamais à un schéma préétabli. Il est même assez difficile de le placer dans une catégorie de l’abstraction, de l’origine à nos jours. Il fait figure d’énergumène, mais pas dans un sens péjoratif. Il n’appartient à aucune école et n’entends pas en fonder une. Son anarchie stylistique ne correspond cependant pas à une volonté de traiter ses tableaux comme autant de champ d’expérience improvisés.
Il est surtout soucieux de s’éloigner le plus possible de ses prédécesseurs et de ses contemporains en imaginant un univers qui n’a pas de fondement. Ou, tout du moins, aucun autre fondement que son désir, qui aspire à gouverner l’espace avec liberté et en exprimant sa propre sensibilité et ses fantasmagories les plus intimes. Bien sûr, on peut être surpris de ne pas découvrir une sorte de fil d’Ariane dans ses créations. En réalité, il y en a plusieurs, mais qui ne sont pas systématiques. Par exemple, il a parfois voulu diviser la toile en deux parties se trouvant en contraste.
Cette division est arbitraire, mais lui consent à imaginer de nouvelles solutions plastiques, qui ne donne pas naissance à une nouvelle génération dans son écriture, mais élargit le champ de ses possibles. Être abstrait ne signifie pas renoncer à un certain ordre et à une certaine cohérence formelle, qui se déclare sous apparence d’un chaos. Regardons le ciel la nuit et nous voyons des centaines, des milliers d’astres de toutes formes et brillent avec plus ou moins de force. Les astronomes y ont découvert des ajustements complexes, parfois étranges, mais qui ont un sens. C’est un peu ce qui se produit dans son propre univers. Il ne faut pas prendre un tableau pour le confronter à un autre: il faut considérer le tout de son entreprise plastique. Si nous la prenons comme un tout, avec toutes ses différences, elles prennent une signification assez curieuse, mais qui a sa raison d’être.
Somme toute, l’artiste réfute toute règle et peut, quelques fois, introduire un élément figuratif (ou un élément qui nous semble tel). Et pourtant, chaque composition possède son ordre particulier. Je comprends ça – comme un dérèglement volontaire de ce qui constitue l’imposition d’un processus qui se développe et qui évolue au fil du temps. Dans son cas, on ne parvient pas à cerner ses intentions. Il nous est uniquement possible de contempler ces formes et ces couleurs combinées. Elles peuvent séduire ou non. Mais elles ne proposent pas une vision de l’univers ni même une construction intellectuelle de l’espace. Elles sont, telle qu’en elles-mêmes, comme une poésie en suspens dans l’attente que notre regard les appréhende et leur donne une légitimité esthétique. C’est là un jeu risqué car le spectateur est conditionné par son expérience et sa culture, sans compter sa sensibilité.
Que Claude Gesvret ait choisi de ne pas produire des cycles ou des séries d’œuvres ou même une écriture qui le fait reconnaître aussitôt (je songe, par exemple, à Cy Twombly) peut donner l’impression qu’il déroge à une des conditions de l’art abstrait qui impose que l’identité du peintre ou du sculpteur soit reconnaissable sans coup férir peut déranger. Mais son style consiste justement à multiplier à l’infini les solutions plastiques. Sa cohérence réside dans ces changements de dispositifs qu’il a traités sur la toile. C’est an fond sa signature.
Qu’on n’aille pas croire que le hasard ou encore la dérision soient le sens de sa démarche. Chacune des pièces produites a sa vérité. Et puis, il ne change pas sans cesse de tonalité ou de mode d’expression. Si l’on entre dans son atelier, l’on peut remarquer une sorte de cohérence dans ce qui pourrait d’abord paraître un éparpillement forcé. C’est un effort assez difficile pour quitter ce qui fait le mouvement de la pensée d’un créateur.
Poussin, Le Caravage, Ingres et plus tard Matisse ou Soutine ont tenu à marquer de leur empreinte chaque tableau d’un moment de leur aventure. Seul peut-être Pablo Picasso a eu le désir de changer souvent d’orientation: mais rien à faire, c’était toujours un Picasso que nous découvrions du cubisme à ses ouvrages figuratifs. En sorte que les peintures imaginées par l’artiste exigent une nouvelle interprétation et une nouvelle relation. C’est le questionnement du Sphinx qui se renouvelle chaque fois et qui exige des réponses très diverses. Au lieu de rechercher les stades qu’il a traversés, on est capté par la nouveauté de la proposition qu’il nous soumet.
Ainsi, le jeu nous amène à tirer de toute nouvelle «mise en scène», comme si la comédie ou la tragédie présantaient à ce point précis de notre circumnavigation une leçon inédite et qui cependant complète ce qu’ont a pu apprendre de ses autres compositions. L’abstraction, sous sa conduite, change profondément de procédé et sa réception nécessite une autre manière de l’approcher et de l’appréciée.
De paradoxe en paradoxe, l’œil apprend à connaître ces signes et ces espaces colorés et doit recommencer à répondre à ses questions insidieuses. La peinture est une curieuse forme de poésie, qui ne n’a de laisse de se proposer chaque fois sous des configurations insolites et imprévues. Mais c’est aussi ce qui fait son charme. Rien n’est prévisible, rien n’est donné d’avance. Nous sommes obligés de ne pas nous arrêter à des clauses qui se répètent. C’est un autre monde qui surgit tout d’un coup, mais ce monde a affaire avec bien d’autres mondes qu’il a découvert auparavant et qui ne se reproduisent pas mais laissent un souvenir. Il est indispensable de s’égarer dans ce labyrinthe et d’y puiser les ressources d’une intelligence nouvelle de l’art. C’est demander beaucoup. Mais c’est aussi gagner beaucoup.

Claude Gesvret n’a pas voulu faire surgir une nouvelle modalité de la beauté. Il n’a pas non plus voulu parvenir à l’abolition de toute beauté dans son travail. Il s’est appliqué à découvrir ce qui, dans une peinture, peut à la fois être du ressort de la beauté et ce qui s’y oppose. C’est là une enquête minutieuse et acrobatique pour parvenir à maîtriser une pensée qui est contradictoire par définition. Du moins, a priori.
Plus le spectateur parvient à mettre à part ses propres qualifications, plus il a la possibilité de jouir de ce lieu si troublant qui est inconfortable et même, au début tout du moins, peu agréable. L’œil refuse cette façon d’architecturer dans un apparent désordre ce qui serait l’essence de sa représentation d’une poésie qui se passe des mots et même de la formation d’un état souverain du tableau, qui s’est peu à peu élaboré dans son esprit. Est-ce une entreprise anarchique ou transgressive? Pas exactement.
C’est quelque chose qui aurait plus à voir avec ce qu’Arthur Rimbaud et qu’Isidore Ducasse ont pu faire en leur temps pour faire connaître le sens de leur investigation poétique. Je n’irai pas jusqu’à dire qu’une toile de cet artiste serait une sorte de Bateau ivre réservé à cette «poésie muette» que serait censé être l’art pictural. Son art pictural est l’expression d’un détournement permanent de ce que nous ont enseigné les peintres d’autrefois (et cet autrefois peut être relativement récent) et aussi un défi lancé à chacun d’entre nous: nous sommes en mesure d’abandonner les idées reçues, notre connaissance, notre éducation sensorielle pour nous hasarder sur des continents qui porte en lui des réminiscences, mais contient beaucoup de pièges qui interrogent notre regard et donc notre pensée. Ce besoin d’égarer son interlocuteur est prégnant, est la nature de son procédé – un procédé qui ne cesse de se renouveler et de proposer des points de vue autres. L’égarement, ce n’est pas une donnée inconnue dans la peinture.
Pablo Picasso en avait fait sa marque de fabrique en de nombreuses occasions. Ce qui ne l’a pas empêché – tout comme d’ailleurs Marcel Duchamp – de chanter les louanges de Jacques-Dominique Ingres! Oui, c’est un passage constant entre le devenir imprévisible et un passé magnifié qui est notre étoile polaire. Ici, la boussole est dérèglée et nous voici en train de naviguer entre deux instances temporelles. C’est ce qui nous dérange. Et c’est ce qui nous fait progresser dans notre jugement.